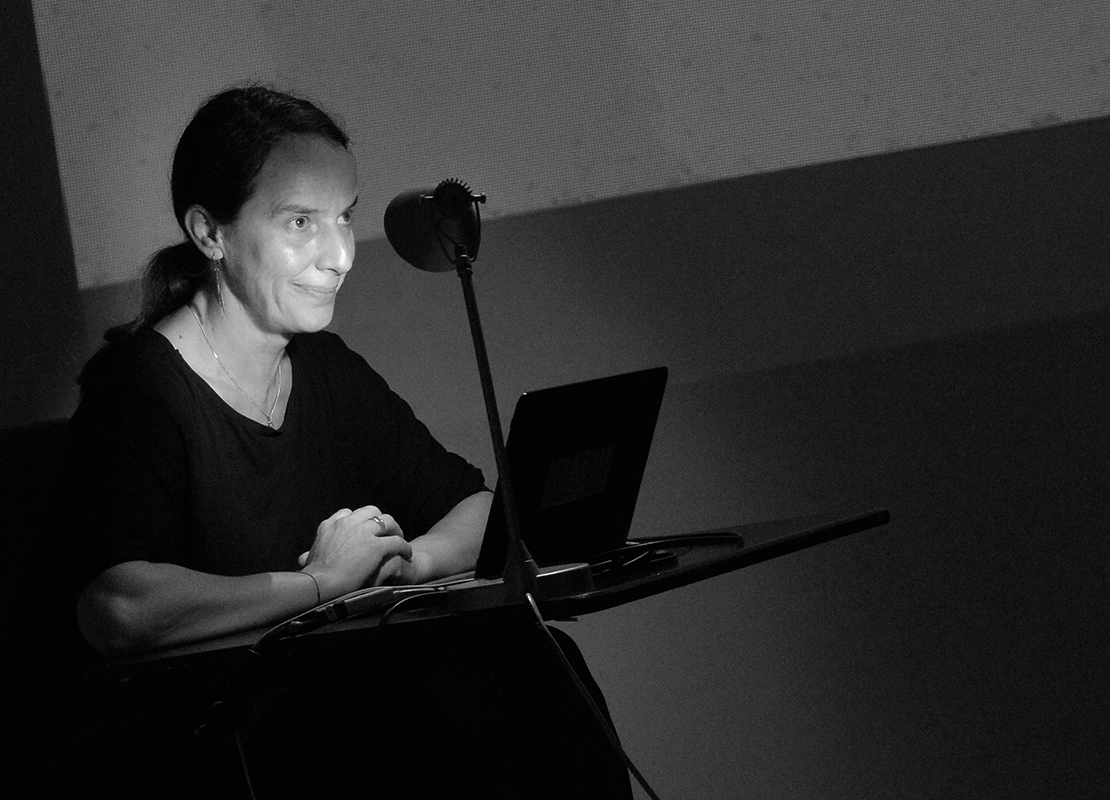On nous propose d’apprendre à lire le plus rapidement possible pour devenir un urbain moderne, adapté, performant. C’est oublier qu’on ne lit pas pour gagner du temps, que la connaissance n’est pas un stock ou un capital, que l’opération de lecture est avant tout un compostage lent, changeant, et qui progressivement met en place un métabolisme collectif.
La vitesse, nous l’aimons, nous l’aimons déraisonnablement, nous l’aimons pour elle-même. Dans la rue nous voulons marcher vite, sur les sites de rencontre nous voulons vite conclure. Nous ne voulons pas perdre de temps dans les files d’attente, nous voulons des retours sur investissement rapides, nous adorons les recettes de cuisine express, et nous sommes globalement impatients de savoir à quelle sauce nous allons être mangés. Et ça fait longtemps que ça dure. Et c’est comme ça pour tout. Par exemple ce texte, vous avez hâte de savoir de quoi il va vous parler, et peut-être avez-vous regardé le discret ascenseur de la page pour avoir une idée du temps que ça prendra pour en arriver au bout. Lire aussi, ça doit aller vite.
La fascination pour la lecture rapide est très répandue, si l’on en juge par la prolifération des méthodes proposées. Et s’il y a publicité c’est qu’il y a marché. D’ailleurs, il y a souvent marché du fait même qu’il y ait publicité. C’est un peu comme cette histoire de l’existence qui précède l’essence : la réclame précède le besoin. Mais ceci est une autre histoire, à moins d’ailleurs que ce ne soit la même, sempiternellement la même, celle où il est toujours possible de nous refourguer ce qu’on ne voulait pas.
À longueur de page Amazon, on nous propose d’apprendre à lire rapidement, et même, le plus rapidement possible. Essayons de décrypter la promesse qui nous est faite, et à quel imaginaire elle renvoie.
Voici quelques-uns des titres de ces innombrables ouvrages proposés :
Lecture rapide – Les méthodes vraiment efficaces
La lecture rapide sans pseudosciences ni blablas : Apprenez vite & mieux
Doublez votre vitesse de lecture en 30 jours!
La promesse qu’on comprend tout d’abord, c’est celle-là : devenez enfin bon élève. Le lecteur lent est un idiot, un bouseux, quasiment un analphabète. C’est celui qui, au pupitre du fond, ânonne la leçon du manuel en suivant les lignes du bout de son index encore rougi par les travaux des champs. Ses ongles sont mal coupés et noircis, il ne sait pas se tenir droit.
Si vous apprenez la lecture rapide, vous serez un urbain moderne, adapté, performant. Vous saurez lire les news et vous serez dans le flow.
Mais d’autres titres d’ouvrages nous mettent la puce à l’oreille, nous montrent que la promesse ne s’arrête pas là :
Connaissance illimitée – Hackez votre cerveau avec le vice-champion du monde de lecture rapide
LECTURE RAPIDE : Apprendre à utiliser efficacement un Soft skill d’Officier.
Le pouvoir de la lecture rapide : Décuplez votre vitesse de lecture et absorbez toutes les informations dont vous avez besoin en un temps record !
Coffret productivité maximale
Sans Limites : Améliorez votre cerveau, apprenez plus rapidement, et libérez votre potentiel exceptionnel
Vous voyez que c’est encore plus fort que ce que nous pensions : ce n’est pas deux fois plus vite que nous pouvons lire, mais dix fois plus vite. Et même, vous pouvez voir des vidéos où les adeptes de la lecture rapide lisent en feuilletant un pavé de 1 500 pages, façon flipbook. En quelques secondes c’est plié.
Et l’on comprend que la véritable promesse, ici, ce n’est pas seulement d’être adapté à ce monde qui demande des gens rapides, c’est d’être exceptionnel, c’est d’être au-dessus des autres : un officier, un champion du monde, un cerveau hacké et amélioré. Tony Buzan, l’inventeur de la lecture rapide, n’hésite pas à convoquer Léonard de Vinci, Einstein, et clame cela : nous sommes des génies en puissance. Il ne s’agit que de saisir l’opportunité de sortir de notre gangue auto-limitante, pour être enfin au-dessus de la mêlée.
Le lecteur lent, dans cet imaginaire, est encore pire qu’un bouseux : c’est un oisif. Qu’il reste au lit le dimanche matin à dévorer un roman au lieu d’aller faire du jogging, ou à sa table de bibliothèque faiblement éclairée dans le crépuscule d’un après-midi d’hiver, aux prises avec une thèse ardue, c’est de toute façon un non-rentable, donc un inutile. Les écrivains aussi, par parenthèse : coucher sur le papier, c’est bien un truc de lascif et de paresseux.
Surtout, dans ce modèle, on reconnait la mythologie des fabuleuses réserves de productivité, et donc de croissance. L’idéologie du no limit.
Parfois, les titres se teintent d’une touche New Age pas du tout incompatible avec cet esprit productiviste, comme par exemple celui-ci :
La Magie de la Lecture Rapide : Accélérez votre Apprentissage et Épanouissement Personnel
[Comment déjouer cette magie du speed et du binge ? La première chose sans doute, c’est d’affirmer qu’on ne lit pas pour acquérir.]
Nous sommes donc en face d’une promesse à deux étages :
Étage 1 : Vous allez apprendre à lire rapidement par obéissance (pour être bon élève)
Étage 2 : Vous allez apprendre à lire rapidement par goût du pouvoir (pour être supérieur aux autres)
On perçoit la petite contradiction du système, qui veut que, pour être conforme, il faut être au-dessus du lot.
Mais il y a encore un étage dans cette promesse qui vous fait fuser bien au-dessus de la gravité du commun des mortels, un étage caché, car cette magie de la lecture rapide aime forcément les double-fonds. Cette promesse cachée, ce troisième étage de la fusée, c’est :
Vous allez apprendre à lire rapidement pour ne plus perdre votre temps avec les bouquins. Car lire, fondamentalement, c’est du temps perdu. S’il y a quand même quelque chose à tirer des livres, l’enjeu est de les presser comme des agrumes et de gober vite leur jus, pour ensuite aller s’occuper des choses sérieuses.
La connaissance est appréhendée comme un stock, un capital. Un capital qui par ailleurs ne vaut pas pour lui-même, mais constitue une valeur intermédiaire, une étape possible pour le vrai grand jeu.
Que peut-on opposer à ce modèle effrayant où lire c’est se transformer en entonnoir, en tiroir-caisse de l’intellection héroïque à haute teneur d’individualité ?
Comment déjouer cette magie du speed et du binge ?
La première chose sans doute, c’est d’affirmer qu’on ne lit pas pour acquérir. Du moins en littérature. L’enjeu n’est pas de stock, mais de flux. La question c’est ce qui se passe au niveau de la tête de lecture. Tête de lecture, expression qui renvoie à la musicalité, à l’instant, à l’intensité. À la précision aussi, autant qu’à la fragilité. On manipule une tête de lecture avec douceur. C’est important. Sinon ensuite elle lit n’importe comment. Une tête de lecture n’accumule rien du tout, elle sent seulement passer sur sa pointe, qu’on souhaite la plus fine possible, les infimes variations de relief, les accidents, les vicissitudes du chemin.
Vous avez sans doute un jour ressenti l’immense frustration de mettre un vinyle sur une platine, et de voir le bras glisser en une seconde, déraper comme ça sans contrôle jusqu’au centre du disque. Sans contrôle, et sans musique. La lecture rapide, c’est ça.
Ensuite, il y a ce fait qui fout toute leur théorie en l’air, qui est qu’on ne lit pas pour gagner du temps, mais pour le passer. Passer le temps, passivement, se passer du monde et de ses affaires utiles à régler, se laisser traverser par une durée qui n’est plus d’attente ou d’occupation, une durée sans nécessité.
Une autre chose, mais qui m’est peut-être plus personnelle, c’est que si je lis c’est pour ne pas comprendre. Buter sur un mot n’est pas une honte, mais bien une chance : enfin quelque chose nous retient. Ou bien se rendre compte qu’on lit mais qu’on n’y est pas, revenir trois fois sur le même passage pour qu’enfin quelque chose se rende disponible : c’est se donner la possibilité de reprendre présence à soi-même. Ou bien encore, comprendre tous les mots mais comprendre que quelque chose nous échappe, parce que trop nouveau, trop différent. Lire, ce n’est pas pour être intelligent, mais bien pour faire l’expérience de l’idiotie. La sienne, celle de l’autre qu’on lit, au sens ou l’idios est étymologiquement ce qui appartient en propre à quelqu’un. Deux étrangetés se font face, se reconnaissent, en restant opaques l’une à l’autre.
Mais revenons un moment à la lecture rapide. Non pas à sa promesse, mais à sa méthode. Une des clés du truc, c’est de supprimer la subvocalisation. C’est d’apprendre aux gens à lire sans faire cette opération mentale qui consiste à se parler intérieurement à soi-même, à se faire la lecture à voix haute, mais en silence. En supprimant cette vocalisation, on gagne du temps. L’enjeu ultime, donc, c’est supprimer le marmonnage. Il faut que le texte rentre par les yeux, aille directement au cerveau, sans passer par la bouche. C’est comme une transfusion directe de sucre rapide, sans s’emmerder à mâcher tout ça.
Je viens de terminer le livre d’Élise Goldberg, Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie. Avec délicatesse, avec humour aussi, elle raconte par petites touches son rapport à la cuisine ashkénaze, à son histoire familiale, à la culture yiddish qui inexorablement s’évanouit au fur et à mesure des décès des plus vieux.
J’ai été frappée par ce passage : « on les a sur le bout de la langue, là où fourmillent les papilles. Les mots nous emplissent la bouche, sollicitent la mâchoire. Les mots sont des mets que l’on mastique. Nourriture que l’on concasse des molaires pour en faire des gru-mots. Mâcher ses mots. Simplement, ils sortent du corps plutôt que d’y entrer. La langue qu’on apprend, c’est comme la nourriture qu’on absorbe, il faut le temps de la métaboliser, de la digérer. »
La vocalisation, qu’elle soit à voix haute ou silencieuse, c’est l’acte qui permet que le texte puisse être accueilli dans toute sa saveur, dans toute sa force nutritive. La connaissance c’est quand le texte s’est fait corps, sinon c’est juste de l’info.
Dans l’Apocalypse, il est dit « Va prendre le livre ouvert dans la main de l’ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. »
Puis « Je m’avançai vers l’ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit : “Prends, et dévore-le ; il remplira tes entrailles d’amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel.” »
Dans Manger le Livre, Gérard Haddad nous le dit : le petit d’humain est d’abord infans, soumis au langage certes mais non encore capable de parler, puis acquérant la parole. Manger le Livre devient le mécanisme qui confère à l’enfant sa langue. Autrement dit, rejeter la vocalisation dans la lecture, c’est se rendre muet.
J’avais commencé Anthropologie du Geste de Marcel Jousse il y a quelques années, et j’avoue ne pas l’avoir terminé, comme de nombreux autres livres lus sans doute trop lentement, et qui pourtant m’ont constituée, par le peu si intense que j’en ai retenu, et par l’espoir aussi d’une future nouvelle rencontre avec eux. Je découvre en préparant ce texte que Marcel Jousse a écrit aussi ce livre, La manducation de la parole. Ainsi est-il présenté sur la quatrième de couverture : « L’homme est un animal mimeur qui rejoue le monde par tout son corps et, notamment, par les muscles laryngo-buccaux moins dispendieux d’énergie. À la communication abstraite et nécrosée par l’idée, Jousse oppose l’acte concret de connaître dans une expérience vitale. C’est le corps entier qui est concerné dans ses gestes, son rythme et son souffle. »
En naviguant un peu, je tombe sur cette citation tirée de l’ouvrage : « L’être humain doit être saisi depuis la plante des pieds jusqu’au sommet de la tête. Il n’y a pas de tête bien-pensante, il y a un composé humain qui connaît et mime par tout son corps… La pédagogie audio-visuelle est une pédagogie de cul-de-jatte. »
[Il nous faut proposer un autre modèle que le flipbook pour penser la lecture, où l’on puisse rendre compte de ce qu’il y a d’organique, de forcément lent, de nécessairement pluriel, dans l’acte de lire.]
Je pense au métavers de Zuckerberg, où effectivement nos avatars n’ont pas de pieds. Un peu plus loin, j’apprends que Marcel Jousse propose une explication de l’Eucharistie qui reprend l’histoire de l’Apocalypse, manger le rouleau de la révélation, mais où là le texte passe de corps à corps : celui qui parle se donne en nourriture à celui qui l’écoute. C’est ainsi que le Verbe se fait chair.
Attention : ce n’est pas une métaphore. Je ne suis pas en train de ressortir du placard l’expression de « nourriture spirituelle », qui insinue qu’il y aurait deux tuyaux, un pour nourrir son corps, qui serait un peu cracra, et un autre plus éthéré pour nourrir son âme. Ce que je dis, c’est qu’il y a une circulation permanente du verbe entre deux états, l’état scriptural et l’état charnel, et cela passe dans tous les cas par l’organe buccal. Que nous lisions ou écoutions un texte, nous sommes des anthropophages, nous nous nourrissons de la chair d’autrui, de cet inextricable tissu charnel fait de verbe et de vécu.
Et si on admet cela, que le cerveau n’est pas un tiroir-caisse blindé qu’on remplit à ras bord, qu’il n’existe pas indépendamment des autres organes et de la chair qui frémit, que tout cela qui fait corps humain n’existe pas non plus indépendamment des autres corps sensibles qui tout autour s’entrebouffent, il nous faut bien proposer un autre modèle que le flipbook pour penser la lecture, où l’on puisse rendre compte de ce qu’il y a d’organique, de forcément lent, de nécessairement pluriel, dans l’acte de lire.
La digestion, donc ? Oui bien sûr, ça se tient. D’ailleurs, personnellement, j’éprouve un irrésistible besoin de dormir après manger comme après lire, de la même façon. Mon corps m’intime le repos pour rêver tout cela qui est entré à l’intérieur de moi, pour que l’autre devienne moi et que je devienne autre. Mais la digestion d’un seul corps, cela ne suffit pas à penser dans quoi on s’embarque quand on commence à lire.
Il se trouve que dans la copropriété où j’habite, il y a une petite allée pavée qui mène aux bâtiments du fond de parcelle, et dans l’allée, un composteur. Il se trouve que j’aime passer le temps à lire, mais aussi à tailler les branches des diverses lianes qui poussent dans l’allée. Si je n’y veillais pas (car honnêtement je suis la seule à y veiller), les lianes finiraient par envahir l’étroit passage, et moi j’en serais réduite à dormir indéfiniment enfermée derrière les feuillages. Je n’ai plus l’âge d’être Belle au bois dormant.
Donc je coupe, et je remplis le compost, à la fois d’épluchures, de feuilles mortes, de longues tiges vertes et de branches ligneuses, et cette activité me demande du temps, car pour que les branches se désagrègent, il faut les couper en tout petits tronçons. Je passe donc des après-midis, le dimanche, à couper des cheveux en quatre devant mon compost, et cette activité si improductive me fait beaucoup penser.
À regarder vivre ce compost, car c’est un milieu éminemment vivant, je me dis qu’il donne une image plus précise et plus juste de ce qui pour chacun d’entre nous fait culture. Plus précise et plus juste que quoi ? Que l’image d’une bibliothèque bien rangée, ou d’un internet mondial lové dans notre paume, faisant apparaitre d’un clic, depuis les profondeurs insondables de serveurs lointains, des textes inaltérés.
Dans le compost, les états ne sont jamais les mêmes, et ça grouille. Tout se désagrège, tout se renouvelle, et tout cohabite. Parfois je soulève le capot, et de minuscules collemboles me saluent en faisant des pirouettes. Parfois une araignée s’est mise sur le dessus pour choper quelques insectes attirés par le festin. Parfois un beau ver de terre bien gras émerge et puis replonge. La pomme gâtée que j’ai mise l’autre jour a verdi, puis bruni. Des bactéries innombrables apposent discrètement leur signature par telle ou telle odeur, plus ou moins subtile. Toute une foule se nourrit et redonne. De la même manière, l’opération de lecture est un compostage lent, changeant, qui progressivement met en place un métabolisme collectif, qu’il faut continuer de nourrir.
Il se passe toujours quelque chose dans un compost. Parfois il y a même des mauvaises surprises : un voisin a déversé dedans un gros tas de polystyrène (ce qui me fait penser à cela, qu’en lecture non plus, tout n’est pas forcément bon à lire). Ou alors, un rat a fait une trouée, et c’est bien légitime, de son point de vue, mais si nous lui reconnaissons le droit de cohabiter avec nos épluchures, nous n’aimons pas qu’il cohabite avec nous. Or, nous cohabitons avec le compost. C’est-à-dire que le compost est pour nous une sorte de prothèse biotechnologique (low tech, mais robuste) qui est certes moins portable qu’un smartphone, mais par sa lourdeur même, sa matérialité, son interdépendance forte à la manière dont nous vivons, rend mieux compte de ce qui nous constitue en tant qu’être qui lit.
[Quand on donne un texte à lire, c’est comme si on disait à quelqu’un : viens visiter mon compost.]
Vous me direz, cette figure du compost, finalement, c’est se désavouer, et revenir à une figure de l’accumulation et du stockage. Et bien non, pas du tout. Le compost n’est pas un pot, mais un pot-pourri, littéralement. Un stock normalement ne se désagrège pas, ou s’il le fait, il perd en valeur, alors même que la valeur du compost vient justement de sa désagrégation. Le compost c’est admettre qu’il n’y a pas de vie sans mort, sans décomposition. La lecture aussi, ça ne fonctionne pas sans oubli, et sans ce phénomène si étrange qui fait qu’on a tout perdu de l’histoire d’un livre et qu’on sait pourtant qu’il nous constitue. Quand on retrouve des gros bouts de quelque chose qui sont encore identifiables dans un compost censé être mûr, c’est qu’on a mal travaillé.
Et autre chose merveilleuse : un compost, ça transpire, ce qu’on lui met dedans, en quelques jours, perd énormément d’eau et donc énormément de volume. Donc on a beau lui en remettre dedans chaque jour, il fonctionne toujours à peu près dans le même volume. C’est la figure inverse du tonneau des Danaïdes, figure du désespoir et du découragement, quand on se dit qu’on n’aura jamais fini d’écoper tout ce patrimoine.
En fait, quand on donne un texte à lire, c’est comme si on disait à quelqu’un : viens visiter mon compost. Ou plus exactement, viens visiter le jardin que j’ai fait pousser grâce à mon compost. Et il n’y a pas un jardin pareil. Nous sommes mutuellement les composts les uns des autres, et dans cet entre nourrissage on peut se défaire tranquillement de notions comme celle de l’autorité de l’auteur, ou de propriété du lecteur. Le compost est forcément un commun, ce qui ne l’empêche pas d’être unique.
J’ai pensé bien sûr, en vous proposant cette figure du compost pour penser nos lectures, à la fois comme acte et comme résultat, à Donna Haraway et à ses communautés du compost. Je cite un article qui en parle [1] : « Le compost, qui renvoie étymologiquement au caractère de ce qui est composite, témoigne d’un travail collectif de composition. Plus encore, dans l’usage qu’en fait Haraway, et notamment à l’oral (eh oui, la vocalisation !) on entend singulièrement la distinction des deux syllabes, “com-post”, soit “avec-après”, qui associe le futur à la collectivité. Le compost est une figure matérielle-sémiotique au croisement de l’actuel et du virtuel, du présent et des futurs possibles. »
Et plus loin encore, il est question de « l’humus, cette matière organique issue de la décomposition des végétaux par l’action combinée des champignons, insectes et animaux. L’humus, exemple paradigmatique du cycle vie-mort et de son rôle dans la récupération bio-écologique, pousse les membres hybrides de la communauté à se penser de manière plus-qu’humaine, comme appartenant au genre humus plutôt qu’au genre Homo, c’est-à-dire “le même”, celui qui se fait seul. »
Donc voilà, adoptons la posture de l’humus, de l’humilité, ne soyons pas des surhommes de la lecture, et n’oublions pas aussi que la bonne santé de notre compost de lecture dépend beaucoup du climat extérieur.
Cécile Portier, écrivaine.
Publié sur AOC, le mercredi 28 février 2024.